Éditorial
Numéro 3. Déjà, un style, une manière — une matière — se dessinent. La création littéraire et artistique y occupe une grande place, palette d'odeurs et de couleurs pareille à une mémoire élémentaire. Or, n'est-ce pas au moment où quelque chose s’installe qu’il faut le stimuler, le nourrir ?
Eh bien l'espace est ouvert.
Inédits
Une journée à peine particulière, d'André Gardies
Dimanche 22 avril : premier tour des élections présidentielles. Quelque part là-haut, dans une petite commune de la Margeride, qui ne compte plus que quatre-vingt douze inscrits sur les listes électorales.

Vers 11 heures 30, lorsque je me suis rendu à la Mairie pour quelques photos, la salle était vide à l’exception des assesseurs installés près de l’urne, en attente de "clients". Je leur ai tenu compagnie. Une bonne demi-heure. Personne n'est venu. Le coup de feu s'était produit une heure plus tôt. Tout relatif d’ailleurs ce coup de feu. Une vingtaine de votants tout au plus. À la sortie de la messe qui, cela tombait bien, avait lieu ce dimanche-ci dans l’église de la paroisse. Désœuvrés, pendant un moment on a regardé par la porte-fenêtre les deux pêcheurs qui remontaient le ruisseau :
« Ce sont encore eux ? Ils étaient là déjà, hier. Ce sont les deux de la Loire ?
- Ca fait bien trois ou quatre ans qu'on les voit.
- Je sais pas s'ils prennent grand chose. Y a plus rien maintenant dans les ruisseaux.
- Tu l’as faite, toi, l'ouverture?
- Non, ça fait longtemps que je prends plus le permis. C'est plus intéressant. Sur une douzaine de truites que tu sors, estime-toi heureux si tu en as une de maille, et encore à condition de bien tirer sur la queue.
- Et Marcel, il l'a pris?
- Non, lui aussi a abandonné. Je crois qu'il n'y a plus que Robert. »
Les deux pêcheurs, dans leur tenue kaki, ont continué de remonter le ruisseau à travers pré. Bientôt ils ont eu tendance à se confondre avec la couleur de l'herbe. On a cessé de les observer.
 Ce n'est que dans l'après-midi, vers 15 heures, que les voitures ont été un peu plus nombreuses à s'aligner devant l'ancienne école. Une petite dizaine de véhicules. Mais cela suffit à donner un air exceptionnel, comme s’il s’agissait d’une réunion, d’une battue ou, plus rare aujourd’hui, d’une fête et, plus rare encore, d’un mariage. On ne vient pas seulement pour déposer son bulletin dans l'urne; on prend le temps de bavarder; on s'attarde; on plaisante, les occasions de retrouvailles ne sont pas si nombreuses. Ici aussi le dépeuplement et l’individualisation du travail ont accentué l’isolement.
Ce n'est que dans l'après-midi, vers 15 heures, que les voitures ont été un peu plus nombreuses à s'aligner devant l'ancienne école. Une petite dizaine de véhicules. Mais cela suffit à donner un air exceptionnel, comme s’il s’agissait d’une réunion, d’une battue ou, plus rare aujourd’hui, d’une fête et, plus rare encore, d’un mariage. On ne vient pas seulement pour déposer son bulletin dans l'urne; on prend le temps de bavarder; on s'attarde; on plaisante, les occasions de retrouvailles ne sont pas si nombreuses. Ici aussi le dépeuplement et l’individualisation du travail ont accentué l’isolement.
Juste un peu avant 18 heures, les gens ont commencé de s'installer dans la salle. Le dépouillement reste un moment important. Un de ces moments où l’on semble perpétuer un rituel, celui du regroupement, de la refondation provisoire de l’entité villageoise. Pendant toute la durée de l’égrènement des noms, règne, en dépit des divergences d’idées que traduisent les bulletins, une sorte de communion fragile, précieuse et provisoire. Peu de commentaires tandis que chaque scrutateur trace consciencieusement les barres du décompte. Pas d'enthousiasme particulier ni de joie manifeste, comme si flottait au-dessus des têtes inclinées le souvenir des affrontements héroïques d’antan, dernière trace mentale d’une Histoire qui se distend, s’effiloche, s’amenuise, s’épuise. Songent-ils à ces mâts de cocagne aujourd’hui disparus qui, dans la cour des maisons, faisaient naguère "honneur à nos élus" ? A moins qu’ils ne tentent d’imaginer l’avenir de leur petite communauté, feuille d'automne fragile et pourtant têtue, ballottée aux quatre vents de la poussée européenne ?
Par prudence probablement, les votes en faveur de l’entre-deux centriste ont fait un score important à l’image de ce qui s’est passé pour l’ensemble du département. Quatre-vingt quatre électeurs se sont déplacés.
Combien seront-ils à voter en 2012 ?
Photographies André Gardies – 1 : "Songeurs pendant le dépouillement" - 2 : "Un air de fête"
Variations : Ville Fantôme
Didier Leclerc, photographe, a proposé une série d'images appelée « Ville fantôme » autour de laquelle trois écrivains (Anne Bourrel, Françoise Renaud et Raymond Alcovère) se sont exprimés.

"Ville fantôme 1, 2, 3.
- 06.07.42 - n°45477
- 19°14' E / 50°03' N
- LD/DL
- 19:10 / 24.09.42"
Feuillet n° 17.07.9, d'Anne Bourrel
1, dialogue (homme/femme)
« - Depuis quand ?
- Trois ans.
- Depuis trois ans, il n’a pas dit un seul mot ?
- Pas exactement. Il a commencé, semblait-il, par refuser d’aborder certains sujets. Les plus courants. Le temps qu’il fait par exemple, ça je m’en souviens. Il ne pouvait plus parler de la pluie, du beau temps, des nuages… J’ai cru que c’était un parti pris, une mauvaise humeur passagère. Mais non, ce n’était pas ça, pas du tout.
(Silence)
- c’était déjà là ?
- Oui. Déjà là. Mais on n’avait rien vu venir. On n’avait pas vu ce qui était là, énorme et monstrueux. (Elle souffle la fumée de sa cigarette). Le médecin nous a expliqué, ça commence souvent comme ça : des mots se perdent, semblant s’oublier, ils se perdent et on a beau chercher, rien, trou noir, angoisse. Puis, des pans entiers du vocabulaire s’effondrent et tous les mots peu à peu disparaissent. Inéluctablement. Et puis, maintenant…
- Plus rien ?
- Presque plus rien.
- Il ne parle plus ?
- Il crie, il gémit, il grince. Il répète « tan » pendant des journées entières.
- "Tan"?
- Oui, ça ne veut rien dire, et puis, c’est le seul mot qui lui reste, vous comprenez ?
- … je vois…
- Parfois, je crois l’entendre m’appeler, je crois qu’il m’appelle et qu’il pleure, mais quand je rentre dans sa chambre, non, il n’a rien dit, il n’a pas pleuré. Son visage est impassible et sans larme. Pâle. Il a toujours eu un visage comme ça, très pâle, très calme. Vous vous souvenez, n’est-ce pas, comment il était avant…
- Oui, je m’en souviens. Vous espérez une amélioration ?
- Non, hélas, non.
2, choses entendues (petit garçon, seul)
Il demande depuis quand. Depuis quand quoi ? Elle dit un chiffre, des années. Je sais pas. J’entends pas bien d’ici. Ils disent : ne parle pas, ne parle plus, n’a plus de mots. Je …je sais pas. Ils parlent, eux, de la pluie, du temps qu’il fait. Ils ne disent pas grand-chose. Leurs voix sont… tristes. Oui. Toutes tristes. Et silencieuses. Messes basses. Chcheche. Elle fume. Lui, on dirait qu’il boit, quelque chose, un café, un thé peut-être. Pas d’odeur. Si, odeur légère, d’eau chaude. Elle a des larmes, dans sa voix. Je sais de qui. Je sais quoi. Veux pas savoir. Dehors, des enfants passent sur des vélos, leurs jambes de libellules. Je veux courir dans le soleil, je veux mettre mon doigt dans les fourmis.
3, plus rien que le souffle du vent (même femme, seule)
Champ lumineux parcouru de sillons,
de Françoise Renaud
 Des minutes ou des heures — peut-être davantage — que les ténèbres avaient englouti sa chair jusqu’en ses fibres profondes et avaient envahi sa bouche d’un goût âcre et terreux, à peine le souvenir d’un vaste effondrement, d’un fracas d’outre monde, ensuite ces ténèbres pareilles à une eau couleur d’huître avec végétation et poissons ondulant dans un maigre courant, le fond rocheux vibrant en continu et à l’unisson des parois depuis l’électrochoc alors que sa conscience n’en finissait pas de revenir : lente plaine d’albâtre, soudain plus
Des minutes ou des heures — peut-être davantage — que les ténèbres avaient englouti sa chair jusqu’en ses fibres profondes et avaient envahi sa bouche d’un goût âcre et terreux, à peine le souvenir d’un vaste effondrement, d’un fracas d’outre monde, ensuite ces ténèbres pareilles à une eau couleur d’huître avec végétation et poissons ondulant dans un maigre courant, le fond rocheux vibrant en continu et à l’unisson des parois depuis l’électrochoc alors que sa conscience n’en finissait pas de revenir : lente plaine d’albâtre, soudain plus  lumineuse et parcourue de sillons, sépia pour la plupart et oscillant telles ces colonnes de fumée qu’on voit s’élever au-dessus des villes en ruines, puis reflets, découpures en feuillage et lignes courbes projetées à l’envers des paupières à la façon d’un théâtre d’ombres, celles-ci palpitant au moment de se soulever au prix d’un effort indicible, enfin, pour peser le désastre et constater ce qui restait de son propre corps, de ces jardins et palais qu’il avait tant
lumineuse et parcourue de sillons, sépia pour la plupart et oscillant telles ces colonnes de fumée qu’on voit s’élever au-dessus des villes en ruines, puis reflets, découpures en feuillage et lignes courbes projetées à l’envers des paupières à la façon d’un théâtre d’ombres, celles-ci palpitant au moment de se soulever au prix d’un effort indicible, enfin, pour peser le désastre et constater ce qui restait de son propre corps, de ces jardins et palais qu’il avait tant  aimés alors que des voix s’en venaient par-dessus du chaos, loin, très loin — les sauveteurs sans doute —, voix des hommes en train de sonder les sédiments et de remuer les gravats pour tenter d’arracher des vivants à leur tombeau, comme si quelque chose pouvait encore être sauvé, pensa-t-il, suite à quoi il s’abandonna sans plus de défenses au vacillement vertigineux du gouffre comme s’il avait chuté d’une haute falaise tout au bord de la mer.
aimés alors que des voix s’en venaient par-dessus du chaos, loin, très loin — les sauveteurs sans doute —, voix des hommes en train de sonder les sédiments et de remuer les gravats pour tenter d’arracher des vivants à leur tombeau, comme si quelque chose pouvait encore être sauvé, pensa-t-il, suite à quoi il s’abandonna sans plus de défenses au vacillement vertigineux du gouffre comme s’il avait chuté d’une haute falaise tout au bord de la mer.
Serant, de Raymond Alcovère
 Réveil dans la nuit. Où suis-je ? Encore vivant ? Hésitations. La vie revient. Demain ? On verra. Sensations. Mémoire. Je sais maintenant qu’il n’y a rien, rien à espérer, et tout en même temps, formidable ouverture. J’ai traversé en quelques secondes les siècles, les générations, les océans. Reste la pensée, une trouée dans le temps. J’irai dans cette direction, il ne peut y en avoir d’autre. Le grand vent souffle puissant, indompté. Je suis seul et heureux. La solitude telle
Réveil dans la nuit. Où suis-je ? Encore vivant ? Hésitations. La vie revient. Demain ? On verra. Sensations. Mémoire. Je sais maintenant qu’il n’y a rien, rien à espérer, et tout en même temps, formidable ouverture. J’ai traversé en quelques secondes les siècles, les générations, les océans. Reste la pensée, une trouée dans le temps. J’irai dans cette direction, il ne peut y en avoir d’autre. Le grand vent souffle puissant, indompté. Je suis seul et heureux. La solitude telle  qu’on l’entend est une idée fausse, le monde déborde en moi, je déborde en lui. Libre, ivre de cela, liberté retrouvée.
qu’on l’entend est une idée fausse, le monde déborde en moi, je déborde en lui. Libre, ivre de cela, liberté retrouvée.
Je me souviens d’Istanbul, cette ville biscornue, flottante, fantastique, ouverte. Ciel, profond, immense, étendues bleues, blanches et noires, oiseaux sillonnant poussés par les rafales du vent, la ville balayée.
L’amour avec toi, encore, toujours, sans fin, à chaque fois. Mystère, limites à dépasser, à brûler. Atmosphère chaude de fin d’après-midi, Bosphore perdu dans les nuages blancs et les vapeurs de la terre. Istanbul Venise Naples, même lumière d’or, finement déposée. Le  voyage continue et il continuera toujours, grâce, légèreté, tamis des nuages dans le soleil de janvier, froideur irréelle, plaisir persistant. Envol des goélands. Odeur sucrée des vagues. Je suis, tu es partout en même temps. Naples Istanbul Venise, même lumière d’or, partout où la vie bouillonne. Convulsions de l’amour. Et immobilité. Sur les bords de la Méditerranée. Au centre. C’est à dire en Chine aussi. Dans le livre des Transformations. Immanquablement. Je ne manquerai pas. Pas de fuite possible. Etant et ayant été. Serant.
voyage continue et il continuera toujours, grâce, légèreté, tamis des nuages dans le soleil de janvier, froideur irréelle, plaisir persistant. Envol des goélands. Odeur sucrée des vagues. Je suis, tu es partout en même temps. Naples Istanbul Venise, même lumière d’or, partout où la vie bouillonne. Convulsions de l’amour. Et immobilité. Sur les bords de la Méditerranée. Au centre. C’est à dire en Chine aussi. Dans le livre des Transformations. Immanquablement. Je ne manquerai pas. Pas de fuite possible. Etant et ayant été. Serant.
Notes de Didier Leclerc à propos de Ville Fantôme :
« Le mystère sera préservé autour de ces signes qui titrent de série.
Cependant préciser que nous sommes là au cœur du statut de l’image comme trace d’archéologie du passé dans la relation fiction – réalité.
Toujours cette quête, cette fouille vers l’origine, ce désir à récolter des bribes d’histoire avant que tout ne soit enseveli. »
En moi, de Laurent Dhume
en moi quelqu'un qui pleure
en moi quelqu'un qui hurle
quelqu'un qui du balcon se jette
 quelqu'un qui s'acharne
quelqu'un qui s'acharne
quelqu'un qui sourit dans son lit à la lune apparue par la fenêtre
quelqu'un de blanc
quelqu'un de gris
un chat sur un canapé
un oiseau dans sa gueule
un oiseau traversant un nuage
en moi quelqu'un d'ailé
en moi quelqu'un qui rampe
qui rase les murs
qui funambule sur le muret
patauge dans les flaques et roule dans une chiasse
quelqu'un qui ronge un lampadaire
en moi l'accord majeur
en moi l'accord mineur
le château de cartes et la table rase
la verdure dans le pot, la terre brûlée
et la forêt
en moi la forêt humaine…
photographie Thierry Lamort
(fragment de ‘au monde’, ensemble de poèmes en cours d'écriture)
La bataille, d'Antoine Blanchemain
Du sommet du coteau, l’officier voyait tout. Rien ne bougeait dans la vallée sur plusieurs centaines de mètres, là où, pourtant, ceux qu’il attendait auraient dû se trouver, où ils seraient bientôt, il le savait.
Soudain, il vit se détacher du feuillage devant le rideau d’arbres qui longeait la rivière, comme un élément avancé de la forêt qui s’étendait à l’infini derrière eux. On vit briller ici l’éclat métallique d’un casque, plus loin, celui d’un éperon invisible sur la masse cabrée d’un cheval noir qu’on ne pouvait détacher de l’ombre d’où jaillissait la douceur ouatée d’un nuage qui filait très loin au-dessus de tout cela, où tous ensemble ils s’anéantiraient tout à l’heure.
De là-haut, dans le silence qui précédait la mêlée, il voyait tout et le calme avant la mêlée et l’image d’une robe de mousseline légèrement bleutée, soudain occultée par le nuage, tandis qu’un laboureur égaré semblait fuir la tempête annoncée mais latéralement, sans s’éloigner assez par conséquent, au mépris de toute prudence, alors qu’on entendait, se rapprochant, les premiers coups de fusil partis du magma de verdure et de ciel gris qui cachait tout le reste.
La robe de mousseline se balança un instant et les jambes de la danseuse parurent hésiter avant de se détacher l’une après l’autre et de se fondre dans la fumée bleuâtre du rideau de la première vague d’assaut sans qu’on entende pourtant claquer le départ des balles.
 La vallée était plongée dans le calme de l’attente sans que l’on distingue aucune forme humaine. Les soldats viendraient plus tard, on les verrait bondir et courir vers les premières maisons où d’autres fusils les attendaient. La bataille allait éclater, elle serait terrible et l’officier n’était déjà plus là, indifférent à ce qui allait se passer. C’est le signal de la valse qu’il attendait pour s’élancer sur le parquet ciré, tournoyant seul au milieu du bal, les bras ouverts, le regard vide, la tête encore pleine de ce souvenir si proche du moment où il avait rencontré celle vers qui il courait maintenant et qui s’éloignait à mesure qu’il avançait vers la masse noire et confuse de la cavalerie qu’un bras inconnu avait lancée à toute vitesse, traversant les prés et les labours pour l’engloutir à son tour sans espoir et sans douleur.
La vallée était plongée dans le calme de l’attente sans que l’on distingue aucune forme humaine. Les soldats viendraient plus tard, on les verrait bondir et courir vers les premières maisons où d’autres fusils les attendaient. La bataille allait éclater, elle serait terrible et l’officier n’était déjà plus là, indifférent à ce qui allait se passer. C’est le signal de la valse qu’il attendait pour s’élancer sur le parquet ciré, tournoyant seul au milieu du bal, les bras ouverts, le regard vide, la tête encore pleine de ce souvenir si proche du moment où il avait rencontré celle vers qui il courait maintenant et qui s’éloignait à mesure qu’il avançait vers la masse noire et confuse de la cavalerie qu’un bras inconnu avait lancée à toute vitesse, traversant les prés et les labours pour l’engloutir à son tour sans espoir et sans douleur.
illustration : Rideau, infographie d'Isabelle Blanchemain, 2007
Miniature n°3, de Marie Bronsard
 L'indignation est son état. Il y consent et s'en délecte. Les occasions ne lui manquent certes pas. Le scandale est patent autant que permanent. Qu'il s'agisse des déjections de chiens dans nos cités radieuses, de la presse malfaisante, de la duplicité des politiciens, de l'incurie des édiles, des pédagogues et des médecins, ou de l'inconscience coupable de ses concitoyens, tout le fâche. Partout il flaire le piège, l'illusion ou l'affront. Son sang ne fait qu'un tour. Il s'emporte, tonne, tempête et fulmine. Nul ne peut l'arrêter. Rien ne peut le distraire. Il est déconseillé, alors, de tenter de le modérer ou de plaisanter. Mais la contradiction l'exalte. Il aime à batailler plus qu'à triompher. C'est dans la joute qu'il donne sa pleine mesure, dans la dispute que s'affine sa dialectique. Avoir le dernier mot, finalement, l'indiffère. Quand en sonnerait l'heure, la plupart du temps, il est déjà requis par un autre sujet, tout aussi révoltant.
L'indignation est son état. Il y consent et s'en délecte. Les occasions ne lui manquent certes pas. Le scandale est patent autant que permanent. Qu'il s'agisse des déjections de chiens dans nos cités radieuses, de la presse malfaisante, de la duplicité des politiciens, de l'incurie des édiles, des pédagogues et des médecins, ou de l'inconscience coupable de ses concitoyens, tout le fâche. Partout il flaire le piège, l'illusion ou l'affront. Son sang ne fait qu'un tour. Il s'emporte, tonne, tempête et fulmine. Nul ne peut l'arrêter. Rien ne peut le distraire. Il est déconseillé, alors, de tenter de le modérer ou de plaisanter. Mais la contradiction l'exalte. Il aime à batailler plus qu'à triompher. C'est dans la joute qu'il donne sa pleine mesure, dans la dispute que s'affine sa dialectique. Avoir le dernier mot, finalement, l'indiffère. Quand en sonnerait l'heure, la plupart du temps, il est déjà requis par un autre sujet, tout aussi révoltant.
La colère lui est nécessaire, autant que le pain et l'eau. Quand, rarement, elle le déserte, il s'étiole, il s'ennuie, s'avachit – c'est lui qui le dit. Mais par bonheur, très vite il s'en irrite et se fustige et se condamne et retrouve, retournés contre lui-même, sa verve et son entrain. Ainsi aiguillonné, il peut de nouveau s'attaquer aux questions essentielles qui, sans lui, ne seraient pas traitées, avec courage dénoncées, implacablement tranchées.
L'infarctus, c'est probable, le guette. Il en a soigneusement préparé le terrain. Il est à craindre qu'en réchapper ne l'assagira point.
Illustration : Le Titien, Portrait d'un Vénitien, 1507
Drôle de Zoizeau, d'Arlette Welty Domon

Madame Martinez avait réussi à traverser la ville en plein chaos pour monter dans le dernier bateau en partance pour la France. À ce jour elle avait survécu aux attentats du FLN, aux ripostes sanglantes de l’OAS, à la panique d’un embarquement anarchique sur des passerelles surchargées. Une de ses valises en avait, du reste, fait les frais et ce n’était pas la moindre : celle qui contenait ses photos de famille et une boucle blonde et soyeuse de son fils André, conservée depuis ses quatre ans ; tout ce qui restait de l’enfant mort à douze ans. Ce trésor reposait à jamais par cent mètres de fond dans le port d’Oran.
Existe-t-il encore des paliers de désespoir lorsqu’on pense en avoir touché le fond ? Madame Martinez avait serré les dents et s’était accrochée à son dernier bagage sans lâcher surtout la cage de l’oiseau recouverte d’une couverture sombre pour le protéger. Maintenant sur le pont, assise sur une chaise longue bancale, elle regardait entre deux têtes de passagers la côte oranaise s’éloigner pour toujours.
Alors qu’à l’horizon le ciel et la mer commençaient à se confondre, le roulis s’apaisa et la nausée lui laissa quelque répit. Elle réalisa alors sa situation et laissa les larmes raviner ses joues, en silence
Au matin le pont s’anima et Joséphine Martinez tenta d’apercevoir Marseille et le Château d’If dont les familiers de la Métropole parlaient autour d’elle. Entraînée par la cohue, elle s’agrippait à sa valise tout en essayant de protéger la cage de l’oiseau. Enfin elle foula pour la première fois le sol français. Un service d’accueil avait été mis en place pour acheminer la longue file des réfugiés vers le stand de la Croix Rouge. Joséphine Martinez avançait à petits pas. Dans la chaleur qui régnait sur le quai, l’oiseau s’agitait dans sa cage. Soudain Madame Martinez eut un haut-le-corps : un Arabe s’avançait vers elle.
 « Donne-moi ta valise, madame, je te la porte jusqu’à l’autobus ». Sur le qui-vive, Joséphine Martinez se rebiffa. « Pas besoin que tu m’aides, Ahmed ! Je peux la porter toute seule. » Compréhensif, le porteur insista tout de même : « C’est gratuit madame ». Déjà il avançait la main sur la cage de l’oiseau. Madame Martinez se dégagea brusquement, ce qui eut pour effet de faire glisser la couverture. Un superbe perroquet apparut qui se mit à rouler des yeux affolés. Soudain sa voix haut perchée recouvrit le tumulte : «Al-gé-rie-fran-çaise ! O-A-S !». Tout mouvement se figea instantanément dans un silence glacial jusqu’à ce qu’un rire énorme le rompit. Le porteur arabe s’en étranglait : « Qu’est-ce qu’il est dégourdi cet zoiseau ! ».
« Donne-moi ta valise, madame, je te la porte jusqu’à l’autobus ». Sur le qui-vive, Joséphine Martinez se rebiffa. « Pas besoin que tu m’aides, Ahmed ! Je peux la porter toute seule. » Compréhensif, le porteur insista tout de même : « C’est gratuit madame ». Déjà il avançait la main sur la cage de l’oiseau. Madame Martinez se dégagea brusquement, ce qui eut pour effet de faire glisser la couverture. Un superbe perroquet apparut qui se mit à rouler des yeux affolés. Soudain sa voix haut perchée recouvrit le tumulte : «Al-gé-rie-fran-çaise ! O-A-S !». Tout mouvement se figea instantanément dans un silence glacial jusqu’à ce qu’un rire énorme le rompit. Le porteur arabe s’en étranglait : « Qu’est-ce qu’il est dégourdi cet zoiseau ! ».
Maintenant un fou rire libérateur gagnait tous les passagers. Envolée l’atmosphère pesante ! oublié le drame l’espace d’un instant. Madame Martinez protégeant de ses deux bras la cage de l’oiseau factieux, finit par abandonner sa valise au porteur.
« Mais qu’est-ce que tu es venu faire en France, Ahmed ?
- Je travaille, madame, comme ça mes enfants, au bled, ils peuvent manger. »
Ils ne parlèrent plus jusqu’au car qui devait conduire les passagers vers un hébergement provisoire. Le porteur plaça la valise dans le coffre puis se retourna vers Joséphine Martinez : « Au revoir, madame, porte-toi bien, Inch’Allah ! » Puis, après avoir esquissé son départ, il se retourna et dit : « Moi c’est Saïd, madame, pas Ahmed ».
Photographies issues des archives personnelles de l'auteur
Les oubliés
Nous autres, de Makulusu de Luandino Viera,
par Antoine Barral
José « Luandino » Vieira est le premier auteur que j’ai rencontré à l’époque où j’ai commencé à fouiller les librairies à la recherche d’une littérature latine et africaine.
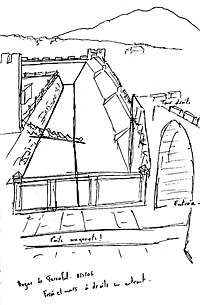 Nous autres, de Makulusu. Une ancienne lecture. Poignante. Un de ces livres qui nous marquent, et que l’on offre le plus souvent possible. J’y ai découvert la vie, celle qu’ignorent les discours sur le colonialisme. La vie d’une famille de petits colons portugais, venus en Angola au temps du salazarisme, quittant la misère du pays natal avec l’espoir de devenir des maîtres. Moins que rien, racistes, cocus du colonialisme puis de la décolonisation. Le narrateur, né en Europe mais le cul entre deux chaises : blanc mais africain, marxiste et anticolonialiste. Son jeune frère, sous-lieutenant dans l’armée portugaise, tombé sous les balles de la guerrilla. Leur demi-frère métis (car colonialisme et racisme n’ont pas empêché le métissage) engagé dans la résistance contre les portugais, capturé par une police tortionnaire.
Nous autres, de Makulusu. Une ancienne lecture. Poignante. Un de ces livres qui nous marquent, et que l’on offre le plus souvent possible. J’y ai découvert la vie, celle qu’ignorent les discours sur le colonialisme. La vie d’une famille de petits colons portugais, venus en Angola au temps du salazarisme, quittant la misère du pays natal avec l’espoir de devenir des maîtres. Moins que rien, racistes, cocus du colonialisme puis de la décolonisation. Le narrateur, né en Europe mais le cul entre deux chaises : blanc mais africain, marxiste et anticolonialiste. Son jeune frère, sous-lieutenant dans l’armée portugaise, tombé sous les balles de la guerrilla. Leur demi-frère métis (car colonialisme et racisme n’ont pas empêché le métissage) engagé dans la résistance contre les portugais, capturé par une police tortionnaire. 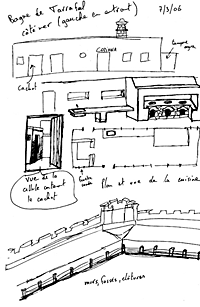 Et tandis que l’on enterre le frère qui se moquait de ses incertitudes d’intellectuel, lui reviennent les images d’une enfance à Makulusu, le « musseque », le quartier misérable où cohabitaient noirs, métis, et petits blancs, où ils jouaient au cerf-volant et s’aventuraient dans la baie de Luanda sur un esquif de fortune… Quelle est la part de l’autobiographie ? « Luandino » Vieira est un de ces Portugais qui avaient choisi l’indépendance de l’Angola. Il le paya de nombreuses années de déportation au bagne de Tarrafal dans les îles du Cap Vert.
Et tandis que l’on enterre le frère qui se moquait de ses incertitudes d’intellectuel, lui reviennent les images d’une enfance à Makulusu, le « musseque », le quartier misérable où cohabitaient noirs, métis, et petits blancs, où ils jouaient au cerf-volant et s’aventuraient dans la baie de Luanda sur un esquif de fortune… Quelle est la part de l’autobiographie ? « Luandino » Vieira est un de ces Portugais qui avaient choisi l’indépendance de l’Angola. Il le paya de nombreuses années de déportation au bagne de Tarrafal dans les îles du Cap Vert.
Ce livre, et d’autres, m’ont conduit des années plus tard sur le chemin de Tarrafal. J’y ai croisé un écrivain finlandais, qui faisait le même pèlerinage. Nous avons arpenté ce rectangle de poussière rouge écrasé de soleil, entouré de fossés, de barbelés, de hauts murs. Latrines, cachots, spectres de jeunes gens maigres et malades… Ici, il avait rêvé de Makulusu.
José LUANDINO VIEIRA écrit la majeure partie de son œuvre au Cap-Vert où il est déporté de 1961 à 1972.
Luuanda (1964) - Autrefois, dans la vie (Gallimard, coll. Du monde entier, 1981) - Nous autres, de Makulusu (Gallimard, coll. Du monde entier, 1989, trad. Michel Laban).
Sur le site web de la librairie Compagnie.
Croquis réalisés au bagne de Tarrafal par Antoine Barral
Chroniques livres
L’amour est très surestimé de Brigitte Giraud,
par Antoine Blanchemain
Il est parti; elle est veuve; elle s’apprête à le quitter; ils se séparent (et les enfants ?), jamais sans doute le thème de la rupture des couples  n’avait été aussi présent dans notre société. En d’autres temps, on y eût consacré de longs et passionnants romans et aujourd’hui les essais et analyses de toutes sortes se multiplient.
n’avait été aussi présent dans notre société. En d’autres temps, on y eût consacré de longs et passionnants romans et aujourd’hui les essais et analyses de toutes sortes se multiplient.
Brigitte Giraud, elle, a choisi d’aller au plus court. Sa phrase, fluide, précise et dépourvue de tout maniérisme l’y autorise. Chaque texte (jamais plus de dix pages) se saisit d’un instant pour en exprimer, jusqu’à l’épuisement, la vérité, si douloureuse, si cruelle qu’elle soit. On lit cela d’un trait et l’on en reste bouleversé. Avec l’envie de lire (de relire) les cinq ouvrages de l’auteur déjà parus.
Éditions Stock, mars 2007
Tes yeux bleus occupent mon esprit de Djilali Bencheikh, par Françoise Renaud
 Un pays : l’Algérie. Un garçon qui s’appelle Salim. À son entour la tribu Benouali : père autoritaire et mère bienveillante avec nichée de frères — difficile de les dénombrer tous — dont l’exilé Miloud en mal d’avenir, Elgoum l’ennemi proche en âge ou encore le turbulent Hamid sans compter quelques sœurs déjà mariées.
Un pays : l’Algérie. Un garçon qui s’appelle Salim. À son entour la tribu Benouali : père autoritaire et mère bienveillante avec nichée de frères — difficile de les dénombrer tous — dont l’exilé Miloud en mal d’avenir, Elgoum l’ennemi proche en âge ou encore le turbulent Hamid sans compter quelques sœurs déjà mariées.
En 1954 Salim a dix ans. Son avenir d’enfant du douar est tout tracé : devenir berger. Pourtant l’école des roumis qu’il fréquente va le conduire au lycée moderne d’Orléansville. Assez des melons et des moutons, il a soif de ville et de jolies filles. Le début du paradis, songe-il.
Mais son pays est en proie au fracas de l’histoire. Lui peine à comprendre, à trouver sa place entre colons et fellagas.
"Quand je serai grand… si l’Algérie n’est pas encore indépendante, je rejoindrai moi aussi le maquis."
C’est vrai que Salim nous amuse, toujours pris entre deux frères, entre deux feux. Il nous amuse quand il raconte son ascension en tête de classe, son apprentissage aux versets du Coran ou son dépucelage — ah ce petit côté « Les aventures du gentil Salim ». Et puis l’air de rien, on rentre dans sa tête d’enfant intelligent à la logique toute personnelle, on participe à ses émotions, on ressent son silence. On retient même nos larmes au chevet de son frère Ahmed terrassé par le choléra.
Entre roman d’apprentissage et autobiographie, entre tendresse et tragédie, le roman de Djilali Bencheikh nous rentre dans le corps. La lecture devient alors un vrai "remède contre l’ennui" et les yeux bleus de mademoiselle Piette rallument l’espoir de rassembler un jour les peuples.
Éditions Elizad, 2007
Sommaire
n° 3 - juin 2007
INÉDITS1 - Une journée à peine particulière d'André Gardies
2 - Feuillet n° 17.07.9 d'Anne Bourrel
3 - Champ lumineux parcouru de sillons de Françoise Renaud
4 - Serant de Raymond Alcovère
5 - En moi de Laurent Dhume
6 - La bataille d'Antoine Blanchemain
7 - Miniature n° 3 de Marie Bronsard
8 - Drôle de zoizeau d'Arlette Welty Domon
LES OUBLIÉS
Nous autres, de Makulusu de Luandino Viera - par Antoine Barral
CHRONIQUES
1 - L'amour est très surestimé de Brigitte Giraud - par Antoine Blanchemain
2 - Tes yeux bleus occupent mon esprit de Djilali Bencheikh - par Françoise Renaud
ARTS PLASTIQUES
1 - photographies de Jean-Louis Bec
2 - dessin de Bernard Mauric
Prochain numéro : septembre 2007
Ours
Comité de rédaction : Raymond Alcovère, Janine Gdalia et Françoise RenaudComité de lecture : Lilian Bathelot, Antoine Blanchemain, Anne Bourrel, Jean-Claude Dana, André Gardies et Dominique Gauthiez-Rieucau
Coordination : Françoise Renaud
Les archives
n° 1 - mars 2007n° 2 - avril 2007
n° 3 - juin 2007
n° 4 - septembre 2007
n° 5 - novembre 2007
n° 6 - janvier 2008
n° 7 - mars 2008
n° 8 - mai 2008
n° 9 - juillet 2008
n° 10 - septembre 2008
n° 11 - novembre 2008
Spécial Eros
n° 12 - février 2009
n° 13 - avril 2009
n° 14 - juillet 2009
n° 15 - novembre 2009
n° 16 - février 2010
n° 17 - avril 2010
n° 18 - juillet 2010
n° 19 - septembre 2010
n° 20 - novembre 2010
Spécial Mémoire
n° 21 - janvier 2011
n° 22 - mars 2011
n° 23 - juin 2011
Spécial Résistances
n° 24 - septembre 2011
n° 25 - décembre 2011
n° 26 - février 2012
n° 27 - avril 2012
n° 28 - juillet 2012
Spécial À Croquer
n° 29 - septembre 2012
n° 30 - décembre 2012
n° 31 - février 2013
n° 32 - avril 2013
n° 33 - juin 2013
Spécial Animal
n° 34 - septembre 2013
n° 35 - décembre 2013
n° 36 - septembre 2014
Index par rubriques
Index par auteurs et artistes


