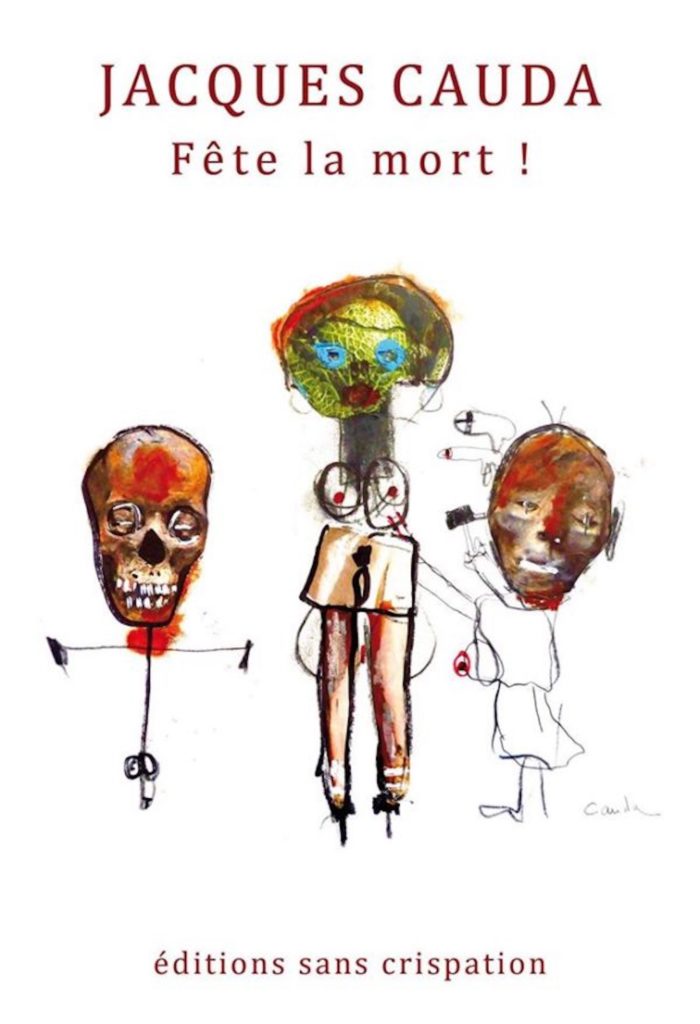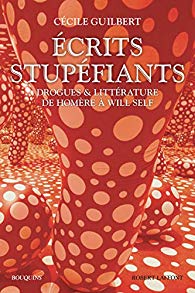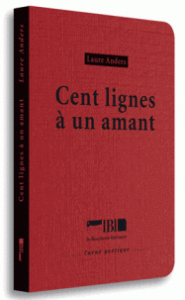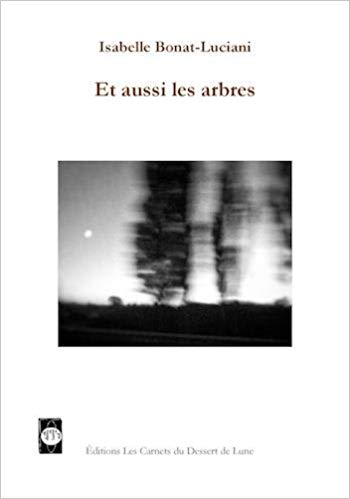Échos de lecture de Jean Azarel à propos du livre Des forêts de couleuvre / Frontalière, de Laure ANDERS (La Boucherie Littéraire, 2020)
Il ne fait généralement pas bon avaler des couleuvres…sauf quand elles habitent les forêts de Laure Anders.
Avec Des forets de couleuvres / Frontalière, Laure Anders nous subjugue de deux textes incandescents qui se suivent (ils auraient pu tout aussi bien s’entrecroiser) sur le même thème d’une relation amoureuse nomade revue et corrigée par le temps.
Lorsqu’on cherche dans un livre quels extraits faire partager dans une chronique, c’est soit très mauvais, soit très bon signe. Ici, la deuxième hypothèse réduit à néant la première. Extraits donc, au gré du hasard des pages ouvertes.
Des lits défaits s’étalent dans le ciel / Plus loin à portée d’horizon constellation de hauts fourneaux / divisant le vert des mélèzes en zones de désir.
En serpentant avec un art consommé de la suggestion qui érotise en point de croix une histoire somme toute banale dont elle transforme le plomb en or, Laure Anders élève haut la condition humaine jusque dans ses bas arrangements de dominant (l’homme) à dominée (la femme).
Si la poésie la meilleure est aujourd’hui très largement féminine (et pas nécessairement féministe), le fait que le sexe dit faible (tout un symbole) soit issu d’un peuple qui a beaucoup souffert, dixit Tonton David, y est de toute évidence pour quelque chose.
Dans ce recueil cueilli et recueilli, le sortilège tient tout entier dans le degré de tolérance complice dont la narratrice fait preuve à l’égard des foucades de son amant. Pas illogique puisque si la couleuvre pique, son venin est inoffensif. Le consentement masochiste de l’auteure, héritière à sa façon du Passe-muraille de Marcel Aymé, vaut autant absolution de la possession qu’acceptation de la flétrissure. Le renoncement choisi au classicisme amoureux, lui permet d’accéder via des rites de passage singuliers à l’initiation intime dans laquelle se reconnaîtront bien des femmes. In fine, « parce que c’était lui, parce que c’était moi », qu’importent le mâle, le comportement, la posture ; la morsure demeure, sous la gouvernance répétitive de la fantaisie, avant la rupture programmée.